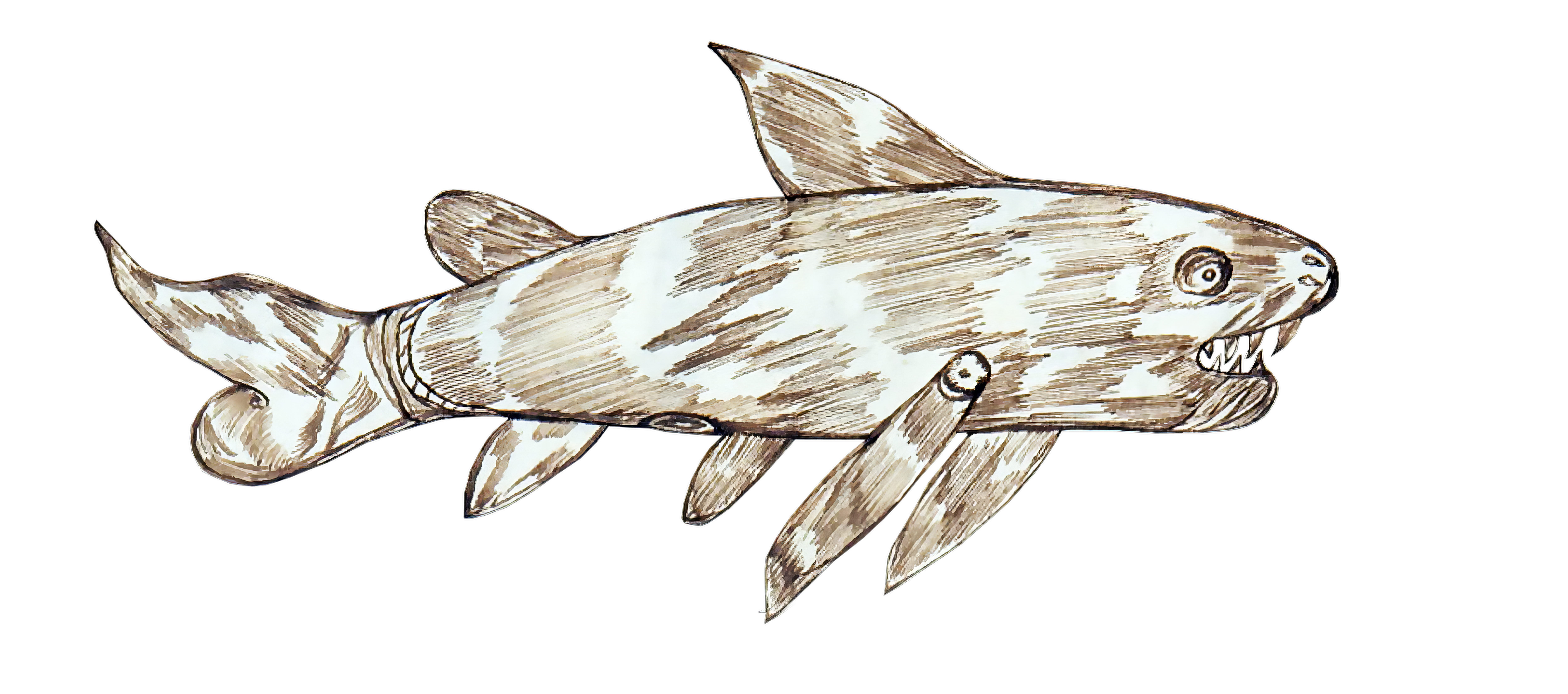11 AOÛT 2025 — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
11 AOÛT 2025
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Présence accrue du requin blanc dans le golfe du Saint-Laurent : Avis destiné aux plongeurs et autres usagers du milieu marin
Présence accrue
du requin blanc
dans le golfe
du Saint-Laurent :
Avis destiné
aux plongeurs
et autres usagers
du milieu marin.
Note éditoriale : Le présent avis n’a pas pour but de sonner l’alarme, mais de sensibiliser le public à la présence du requin blanc au moyen d’un message de précaution fondé sur l’observation scientifique, plutôt que sur l’exagération, la peur ou le sensationnalisme. Nous agissons par souci de sécurité et d’information—et non par obligation—en réponse aux nombreux appels des médias et de citoyens inquiets, ainsi qu’en l’absence de toute communication officielle des organismes gouvernementaux concernant l’augmentation des observations et les signes confirmant la présence accrue de cette espèce dans le Saint-Laurent. Toute couverture médiatique de cet avis—et tout particulièrement les titres—devrait en refléter fidèlement la portée préventive, en évitant toute formulation susceptible de générer une crainte injustifiée ou de prêter à confusion. Cet avis constitue également un contrepoids scientifique aux distorsions virales sur les réseaux sociaux, aux canulars générés par l’IA, aux généralisations excessives des influenceurs, ainsi qu’à la désinformation en général.
⚠ CONTACT MÉDIAS : Aucune entrevue ne sera accordée à propos de ce communiqué.
Version PDF (356 KB)
⚠ MISE À JOUR (13 août 2025) : Incident impliquant un pagayeur et un requin blanc en Nouvelle-Écosse
Golfe du Saint-Laurent, 11 août 2025 — Au cours de la dernière semaine, le signalement d’une rencontre rapprochée entre un plongeur et un requin blanc (Carcharodon carcharias) aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que l’observation, par des plongeurs en immersion ou à bord d’embarcations, de plusieurs phoques gravement mutilés dans la baie des Chaleurs et au large de la péninsule gaspésienne, ont incité l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) à émettre le présent avis à l’intention des plongeurs, nageurs, pagayeurs et autres usagers du milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent.
L’ORS étudie les requins du Saint-Laurent depuis plus de 25 ans, y compris des recherches de terrain consacrées au requin blanc aux Îles-de-la-Madeleine depuis maintenant quatre ans. Ces événements récents, bien que préoccupants, s’inscrivent dans une tendance observée dans tout le nord-ouest de l’Atlantique et ne constituent pas une surprise. Ils reflètent en fait une évolution plus large de la répartition et de l’abondance du requin blanc au cours de la dernière décennie—comme le confirment des publications scientifiques récentes [1, 2],—et concordent avec l’histoire des peuples autochtones de la péninsule maritime, témoignant de la présence du requin blanc dans ces eaux bien avant le contact européen [3].
Bien que le risque statistique d’un incident impliquant un requin au Canada, y compris dans le Saint-Laurent, demeure faible, la probabilité de telles rencontres augmente à mesure que les requins blancs repeuplent le Saint-Laurent et que l’activité humaine s’intensifie dans leurs habitats clés durant la haute saison.
Comportement du requin blanc et facteurs de risque
Comportement du requin blanc et facteurs de risque
Contrairement à l’image de prédateur monstrueux véhiculée par des films comme Les Dents de la mer, le requin blanc est un chasseur hautement évolué, doté de systèmes sensoriels sophistiqués, spécialement adaptés à l’identification de ses proies naturelles. La tendance récente—bien intentionnée mais simplificatrice—qui présente le requin blanc comme indifférent aux humains, et donc inoffensif, est tout aussi erronée et réduit à l’excès la complexité réelle de son comportement. En réalité, la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes et dépend de nombreux paramètres.
Par ailleurs, une publication récente [4] confirme également que le requin blanc n’attaque pas tout ce qu’il croise, et que la théorie de l’erreur d’identification ne suffit pas à expliquer tous les incidents de morsures. Le niveau de risque posé par un requin blanc dans une situation donnée dépend donc de divers facteurs environnementaux et comportementaux, notamment la visibilité sous l’eau, la densité de proies naturelles (comme les phoques), la présence de congénères ou de compétiteurs, ou qu’il soit un juvénile s’initiant à la chasse aux mammifères. La plupart des incidents résultent probablement d’une combinaison exceptionnelle de telles circonstances, où la victime se trouve, à son insu, au mauvais endroit au mauvais moment.
Périodes et lieux à surveiller
Périodes et lieux à surveiller
Jusqu’en 2021, aucune interaction confirmée entre un plongeur et un requin blanc n’avait été documentée au Canada. Depuis, près de dix rencontres ont été signalées en Nouvelle-Écosse, et celle rapportée le 2 août aux Îles-de-la-Madeleine (47.838230, -61.145708) constituerait la première interaction non provoquée dans les eaux du Québec et du golfe du Saint-Laurent. Or, le niveau de risque dans le golfe est accru par le fait que certains lieux de plongée—particulièrement au Québec—abritent quelques-unes des plus grandes concentrations de phoques du Canada atlantique. Parmi ceux-ci, bien que moins fréquentées, les îles de Brion, Corps-Mort et le Rocher aux Oiseaux (ou la rencontre aurait eu lieu), un trio inhabité situé au large des Îles-de-la-Madeleine, présentent désormais un risque significatif.
Jeffrey Gallant, fondateur et directeur scientifique de l’ORS, plongeur depuis 43 ans, insiste sur l’importance de la vigilance situationnelle et de l’adaptation des pratiques de plongée :
« Personnellement, j’éviterais de plonger à des endroits notoirement riches en phoques comme le Rocher aux Oiseaux, le Corps-Mort et l’île Brion pendant la migration saisonnière du requin blanc dans le golfe, soit de juin à novembre. Ces lieux sont manifestement devenus des zones de prédation active, comparables aux îles Farallon au large de San Francisco, où aucun plongeur soucieux de sa sécurité ne mouillerait ses palmes. Dans un tel contexte, la vigilance mentale constante et la peur sous-jacente rendraient toute plongée désagréable pour la plupart. Pour le reste des sites madelinots, comme ailleurs dans le golfe, en l’absence d’attroupements importants de phoques, je n’hésiterais pas à plonger, toujours accompagné d’un binôme, mais je demeurerais néanmoins vigilant, ce qui reste une pratique essentielle en plongée. »
En tant qu’ancien instructeur de plongée, Gallant ajoute :
« Il est essentiel de se rappeler que la sécurité du plongeur dépend non seulement du comportement animalier, mais aussi de son propre état d’esprit. L’apparition soudaine et inattendue d’un requin peut provoquer une panique, en particulier chez les plongeurs moins expérimentés. Même sans confrontation, une remontée trop rapide sous l’effet de la peur peut entraîner des urgences médicales graves, comme une embolie gazeuse ou autre accident de décompression. La préparation mentale et la conscience environnementale doivent donc être considérées aussi essentielles que les vérifications d’équipement ou les protocoles entre binômes. »
Heureusement, ces îles reculées de l’archipel, situées au centre du golfe, demeurent hors de portée de la plupart des plongeurs, sauf pour quelques aventuriers. Toutefois, si la population de requins blancs continue d’augmenter, il ne s’agira que d’une question de temps avant qu’un individu ne soit rencontré à un site de plongée populaire ailleurs dans le golfe. Il nous semble donc essentiel d’adopter une approche proactive fondée sur l’adaptation et la diffusion de connaissances de base sur le comportement des requins afin de continuer à plonger en sécurité et dans le plaisir. Éviter les grands attroupements de phoques, surtout lorsqu’ils demeurent collés au rivage (ce qui peut indiquer la présence d’un prédateur), privilégier les sites en eau claire, plonger avec des armateurs locaux connaissant bien les conditions, et se tenir informé des rapports d’observation peuvent contribuer à réduire considérablement les risques. De même, les nageurs et pagayeurs doivent se montrer attentifs à la présence de phoques, et éviter les zones où ils sont concentrés.
Sensibilisation et sécurité publique
Sensibilisation et sécurité publique
L’ORS n’est ni un organisme public ni une instance gouvernementale, et il ne relève donc pas de notre mandat d’émettre des avis ou d’assurer la sécurité du public. Cependant, en l’absence de toute communication officielle des organismes gouvernementaux sur l’augmentation des observations et les signes confirmant la présence accrue du requin blanc dans le Saint-Laurent, les pratiquants d’activités aquatiques et les médias se tournent instinctivement vers nous pour obtenir de l’information et être rassurés.
Compte tenu du caractère sensible du sujet, qui peut influencer la perception du public, susciter involontairement la peur ou affecter les décisions des usagers et des collectivités côtières, nous avons donc jugé nécessaire de publier le présent avis, que l’ORS n’émet qu’avec la plus grande prudence : il ne s’agit que du deuxième avis de sécurité publique en plus de vingt ans, le premier, en 2005, portant sur la plongée récréative et le requin du Groenland (Somniosus microcephalus) dans la région de Baie-Comeau.
Ce nouvel avis, qui concerne non seulement les plongeurs et nageurs, mais aussi tous les usagers du milieu marin, repose sur des observations de terrain et des recherches en cours menées par l’ORS, ainsi que sur des études scientifiques portant sur le requin blanc, tant au Canada qu’à l’étranger, dans des contextes similaires. En parallèle des efforts en cours à l’échelle du Canada atlantique, l’ORS et ses partenaires amorcent le développement d’une campagne régionale axée sur la sensibilisation aux requins, la conservation, et la sécurité publique. À moyen terme, cette initiative comprendrait notamment l’installation de panneaux d’information et d’avertissement dans les zones publiques et côtières stratégiques, ainsi qu’une collaboration avec divers acteurs afin de mettre en place un programme de sensibilisation et de surveillance, fondé sur la science et coordonné à l’échelle régionale. Conscient que cette problématique concerne l’ensemble du Canada atlantique, l’ORS souhaite également contribuer à des initiatives plus larges aux côtés de chercheurs canadiens, de pêcheurs, de communautés des Premières Nations et d’autorités publiques afin de promouvoir la coexistence entre humains et requins.
Protection légale et comportement responsable
Protection légale et comportement responsable
Alors que le retour en force du requin blanc incite déjà certains plongeurs et usagers du milieu marin à faire preuve de prudence à certains endroits, il pourrait également encourager des amateurs de sensations fortes à rechercher ce prédateur imposant, poussés par la curiosité, la quête d’images spectaculaires ou la visibilité médiatique. Il est donc important de rappeler que le requin blanc est une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada [5]. Ainsi, il est strictement interdit de harceler un requin blanc, notamment en s’en approchant intentionnellement à la surface—ce qui pourrait perturber un événement de prédation ou le blesser—, en le survolant avec un drone, en l’attirant avec des appâts, ou en tentant de plonger en cage sans permis de Pêches et Océans Canada (MPO).
Nous conseillons également aux plaisanciers, particulièrement ceux à bord d’embarcations légères ou pneumatiques, de maintenir une distance minimale de 10 mètres de toute activité de surface impliquant un requin blanc, en particulier lors de la consommation d’un phoque ou d’une autre carcasse, comme ce fut le cas à Gaspé le 31 juillet. Un requin blanc en situation de prédation peut adopter un comportement énergique et imprévisible, et dans de rares cas, heurter un bateau ou mordre accidentellement un boudin ou un moteur, par curiosité ou erreur. Cela pourrait entraîner des conséquences graves, telles qu’une perte d’équilibre ou une crevaison.
Conclusion
Conclusion
Il peut être rassurant pour certains de faire l’autruche face à cette situation qui, il y a cinq ans à peine, semblait impensable. Pourtant, l’océan est en pleine mutation, et nous devons aborder cette nouvelle réalité avec calme, réalisme et optimisme. La réapparition marquée du requin blanc constitue un rare signe d’espoir pour la santé du Saint-Laurent, bien qu’il impose certains défis pour les activités humaines. En nous adaptant à cette situation évolutive, en comprenant les risques et en acceptant quelques compromis raisonnables, nous pourrons continuer à profiter de la mer, tout en intégrant cette présence renouvelée à nos usages et à nos cultures, comme l’ont fait les peuples autochtones depuis des millénaires [6]. Ce faisant, le Canada rejoint la grande communauté des « nations à requins », telles que l’Australie ou l’Afrique du Sud, où la présence de ces puissants prédateurs engendre parfois des conflits, mais incarne également un lien renouvelé avec l’océan vivant et les rythmes sauvages qui le régissent encore.
Pour en savoir plus, obtenir un contexte supplémentaire ou consulter les recommandations à l’intention des plongeurs, nageurs et autres usagers du milieu marin, veuillez consulter le Registre canadien des attaques de requins de l’ORS : https://geerg.ca/attaques-requins
Aucune entrevue à ce sujet
Aucune entrevue à ce sujet
Fondé officiellement en 2003 (sous le nom de GEERG), l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par un petit groupe de scientifiques bénévoles et d’experts issus de domaines complémentaires, tous passionnés par les requins et profondément engagés dans leur vie professionnelle et familiale. Or, tel que mentionné précédemment, l’ORS n’est ni un organisme public ni une instance gouvernementale. En conséquence, nous ne sommes nullement tenus de publier de tels avis, et nous ne recherchons ni visibilité médiatique, ni financement dans le cadre de communications que nous jugeons d’intérêt public.
Notre engagement envers les requins du Saint-Laurent ne date pas d’hier. Actifs dans leur étude depuis les années 1990, à une époque où ces prédateurs mal-aimés nageaient dans l’indifférence, nous avons longtemps œuvré seuls, jusqu’à ce que le retour inattendu du requin blanc suscite une frénésie d’intérêt tous azimuts pour cette espèce emblématique, tant sur le plan scientifique que médiatique. Pratiquement chaque observation de requin suscite maintenant une vague de sollicitations, et nous ne disposons tout simplement pas des ressources pour répondre à une multitude de demandes d’entrevues, souvent reçues sur plusieurs jours, à toute heure.
En raison du risque de dérapage et des préjugés tenaces qui, trop souvent, déforment nos propos ou les faits rapportés—un phénomène malheureusement fréquent dans les reportages sur les requins, ici comme ailleurs—l’ORS ne donnera aucune entrevue à propos du présent avis. Nous invitons plutôt les médias à s’y référer textuellement et sans extrapolation, car il reflète notre compréhension actuelle de la présence du requin blanc dans le Saint-Laurent en lien avec la sécurité humaine. Toute spéculation au-delà de ces faits risque de donner lieu aux interprétations erronées, sensationnalistes ou banalisantes trop communes, qui ne servent ni le public ni la cause des requins.
L’ORS continuera de partager des mises à jour factuelles à mesure que ses recherches progresseront au cours des mois et des années à venir. Cependant, pour toute question relative à la présence accrue du requin blanc et, plus particulièrement, aux risques pour la sécurité publique, vous pouvez vous adresser soit au ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO), responsable de la gestion et de la surveillance de la faune marine, soit à l’organisme compétent en matière de sécurité publique sur le territoire concerné.
Merci de votre compréhension et de contribuer, avec nous, à faire en sorte que la sécurité publique et la conservation des requins restent ancrées dans les faits et le respect.
Jeffrey Gallant, M. Sc.
Fondateur et directeur scientifique
Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS)
RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCES
(1) Allegue, H., Bordeleau, X., Winton, M. V., Skomal, G. B., Joyce, W., Barajas, V. L., Trudel, M., & Bowlby, H. D. (2025). Systematic assessment of the increasing presence of white sharks in Atlantic Canadian waters. Marine Ecology Progress Series, 761, 145–161. https://doi.org/10.3354/meps14855
(2) Bastien, G., Barkley, A., Chappus, J., Heath, V., Popov, S., Smith, R., Tran, T., Currier, S., Fernandez, D. C., Okpara, P., Owen, V., Franks, B., Hueter, R., Madi19gan, D. J., Fischer, C., McBride, B., & Hussey, N. E. (2020). Inconspicuous, recovering, or northward shift: Status and management of the white shark (Carcharodon carcharias) in Atlantic Canada. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 77(10), 1666–1677. https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0055
(3) Gallant, J. (2023. 19 octobre). Registre canadien des attaques de requins (2023:1). Observatoire des requins du Saint-Laurent. https://geerg.ca/fr/attaques-requins
(4) Ryan, L. A., Slip, D. J., Chapuis, L., Collin, S. P., Gennari, E., Hemmi, J. M., How, M. J., Huveneers, C., Peddemors, V. M., Tosetto, L., & Hart, N. S. (2021). A shark’s eye view: testing the ‘mistaken identity theory’ behind shark bites on humans. Journal of the Royal Society, Interface, 18(183), 20210533. https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0533
(5) https://publications.gc.ca/collections/collection_2022/eccc/CW69-14-507-2021-eng.pdf
(6) Betts, M. W., Blair, S. E., & Black, D. W. (2012). Perspectivism, Mortuary Symbolism, and Human-Shark Relationships on the Maritime Peninsula. American Antiquity, 77(4), 621–645. https://doi.org/10.7183/0002-7316.77.4.621
À propos
À propos
L’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS), la toute première organisation non gouvernementale et œuvre de bienfaisance sur les requins au Canada, célèbre en 2025 le 25e anniversaire de sa première expédition de terrain, qui marque également le début de son existence. Cette série d’explorations pionnières dans l’Atlantique Nord, le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent a mené à la création officielle du Groupe d’étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG) en 2003. Elle a également vu les premières plongées en cage avec des requins pélagiques au Canada en 2000 et, en 2003, les toutes premières rencontres naturelles avec le requin du Groenland, lançant une décennie de recherches et plusieurs publications scientifiques inédites sur cette espèce furtive et méconnue. Devenu l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) en 2022, l’organisme concentre aujourd’hui ses activités bénévoles de recherche et de conservation non plus exclusivement sur le requin du Groenland, mais aussi sur l’ensemble des espèces de requins qui habitent le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, le fjord du Saguenay, le Canada atlantique et l’océan Arctique.