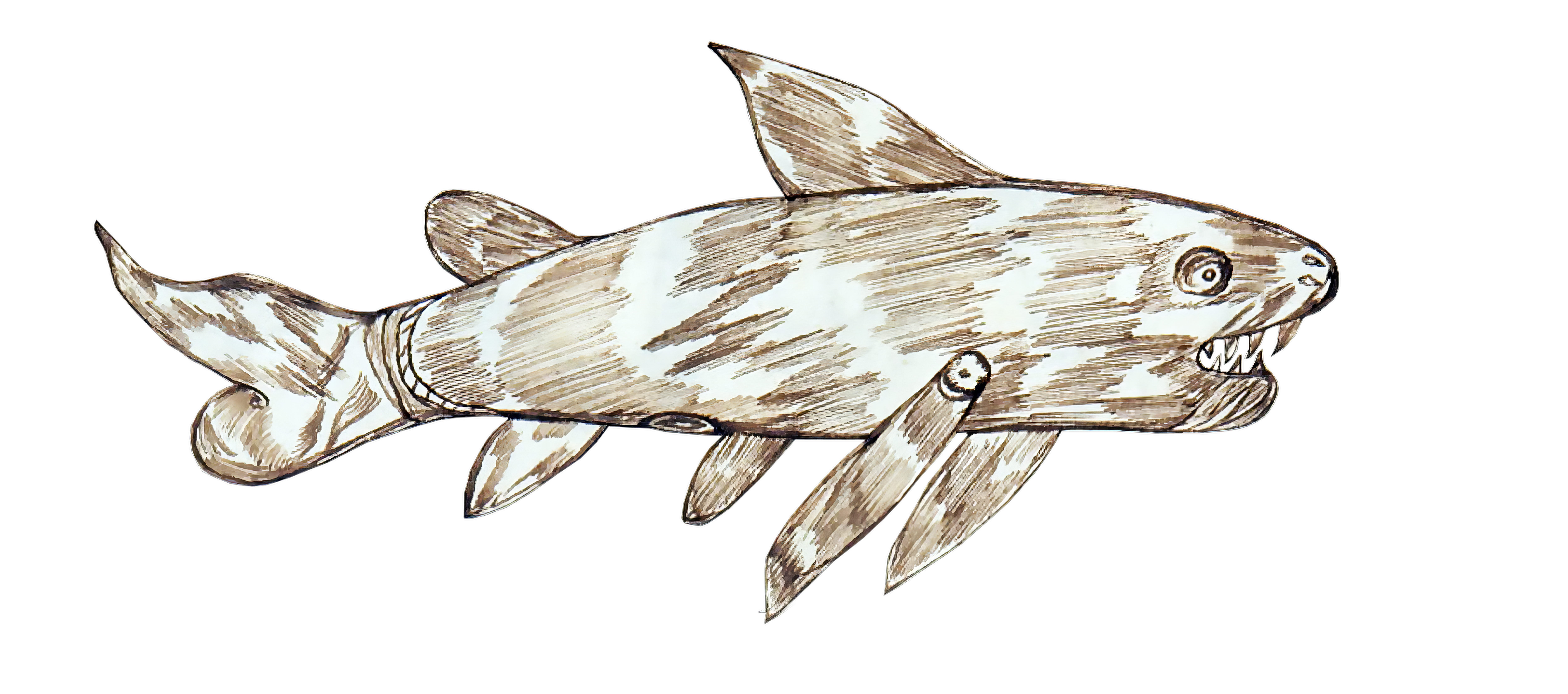13 AOÛT 2025 — POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
13 AOÛT 2025
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mise à jour sur la présence accrue du requin blanc dans le golfe du Saint-Laurent
Incident impliquant un pagayeur et un requin blanc en Nouvelle-Écosse : une première canadienne.
Incident impliquant
un pagayeur et
un requin blanc :
une première
canadienne
Note éditoriale : La présente communication fait suite à celle du 11 août. Encore une fois, le but n’est pas de sonner l’alarme, mais bien de sensibiliser le public à la présence du requin blanc, au moyen d’un message de précaution fondé sur l’observation scientifique plutôt que sur l’exagération, la peur ou le sensationnalisme. Nous agissons par souci de sécurité et d’information—et non par obligation—en réponse aux nombreux appels des médias et de citoyens inquiets, ainsi qu’en l’absence de toute communication officielle des organismes gouvernementaux. Toute couverture médiatique de ce communiqué—particulièrement les titres—devrait en refléter fidèlement la portée préventive, en évitant toute formulation susceptible de susciter une crainte injustifiée ou de prêter à confusion (Voir de récents mauvais exemples ici-bas). Ce communiqué vise également à offrir un contrepoids scientifique aux distorsions virales sur les réseaux sociaux, aux canulars générés par l’IA, aux généralisations excessives des influenceurs, ainsi qu’à la désinformation en général.
⚠ CONTACT MÉDIAS : Aucune entrevue ne sera accordée à propos de ce communiqué. Les médias peuvent citer intégralement le contenu de ce texte ainsi que le commentaire personnel du directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent.
Tel que mentionné ci-haut, évitez les titres sensationnels qui entretiennent la peur et déforment le message, comme l’ont fait certains médias cette semaine :
Espaces, Silo57 : De plus en plus de requins blancs dans le Saint-Laurent : l’Observatoire sonne l’alerte
Nous sommes bien loin de : « Le but n’est pas de sonner l’alarme, mais bien de sensibiliser le public à la présence du requin blanc. » Votre crédibilité repose sur la rigueur et la nuance, et nous savons que vous pouvez faire mieux.
Version PDF (356 KB)
Liverpool, Nouvelle-Écosse, 13 août 2025 — À peine un jour après la publication de notre avis de précaution du 11 août sur l’augmentation des observations de requins blancs—partagé en primeur avec un média madelinot le 4 août—un pagayeur a eu une confrontation directe avec un requin blanc (Carcharodon carcharias) au large de Cherry Hill Beach, en Nouvelle-Écosse (44.140600, -64.510088).
Les marques de dents observées sur sa planche à pagaie (SUP) sont caractéristiques d’un requin blanc juvénile [1]. Heureusement, le pagayeur n’a pas été blessé. Bien qu’il ait été projeté hors de sa planche, il a réussi à y remonter et à repousser le requin, qui y était encore accroché. Utilisant sa pagaie pour frapper l’animal, il s’est échappé avec pour seules conséquences une grande frayeur et une planche endommagée. Afin d’éviter toute diffusion de fausses informations, les détails de l’incident du 12 août seront ajoutés au Registre canadien des attaques de requins à la suite d’une analyse rigoureuse des témoignages et des données. Pour l’instant, bien que l’enquête soit toujours en cours, cet événement correspond en tous points à l’hypothèse que nous formulions lundi—une hypothèse qui, aujourd’hui, prend des allures de prédiction.
L’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS), également éditeur du Registre, précise qu’il s’agit du premier incident impliquant un pagayeur au Canada et seulement du deuxième cas répertorié de confrontation directe avec un usager récréatif de l’eau.
L’autre incident, survenu en août 2021 dans le golfe du Saint-Laurent, au large de l’île du Cap-Breton, impliquait une nageuse ayant subi une morsure ou une entaille à la cuisse, avec observation rapprochée d’un aileron avant et après l’événement. Cet incident, auquel elle a survécu, n’a toutefois pas encore été officiellement confirmé, faute de témoignage direct de la victime.
Comme nous le rappelions déjà, croiser un requin blanc par hasard exige la combinaison de facteurs spécifiques et relève surtout du fait d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Dans le cas présent, il est possible, entre autres hypothèses, que l’animal n’ait fait que passer, en route vers un site de chasse saisonnier.
Encore une fois, nous jugeons essentiel de replacer l’évolution actuelle dans son contexte afin de mieux cerner la notion de risque. En Australie, par exemple, un nombre beaucoup plus important de personnes fréquentent régulièrement l’océan et, depuis dix ans, on y recense en moyenne une vingtaine d’incidents entraînant des blessures chaque année, dont environ 2,8 sont mortels [2]. Toutefois, on y dénombre davantage d’espèces considérées comme dangereuses pour l’humain, ce qui contribue à augmenter le risque.
À l’inverse, l’immensité de l’habitat disponible pour le requin blanc dans les eaux atlantiques canadiennes—particulièrement dans le golfe du Saint-Laurent—, la moindre densité humaine en zone côtière, ainsi que le relatif isolement des colonies de phoques réduisent considérablement la probabilité d’une rencontre fortuite. De plus, seul le requin blanc pose un risque significatif dans le golfe et au Canada atlantique, ce qui contribue aussi à limiter les probabilités d’incident. Cela dit, le risque demeure néanmoins bien réel, comme nous le rappelle l’incident survenu hier.
Éclairage personnel – Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’ORS
Éclairage personnel – Jeffrey Gallant, directeur scientifique de l’ORS
« Dans les années 1990, j’ai travaillé cinq étés comme instructeur de plongée et effectué des centaines d’immersions dans la région de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Notre activité préférée consistait à plonger au beau milieu d’une colonie de phoques, où plongeurs et animaux se côtoyaient sans incident, saison après saison. À l’époque, évoquer la rencontre d’un requin—surtout un requin blanc—déclenchait aussitôt un brin de dérision amicale. On savait que l’espèce avait été signalée à de rares occasions à l’extrémité sud de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais encore plus rarement jusqu’à Lunenburg et au-delà. Rencontrer un requin blanc était donc la dernière chose à laquelle nous nous attendions.
Aujourd’hui, la région de Lunenburg abrite une station de recherche sur le requin blanc aux îles Tancook (Tancook Islands Marine Field Station) et constitue l’endroit le plus actif au pays pour le marquage de cette espèce. Je ne mettrais plus les palmes à notre ancien site de phoques, non que les plongeurs soient devenus des cibles, mais parce que la présence renouvelée du requin blanc, jadis inimaginable, change complètement la donne. Le risque d’un incident y est désormais trop élevé à mon goût.
Et pourtant, je passe à tous les ans une partie de mes vacances en famille à White Point, à seulement 25 minutes du lieu de l’incident d’hier. L’endroit ressemble d’ailleurs à Cherry Hill Beach, avec ses surfeurs, pagayeurs, et pataugeurs partageant le milieu avec un phoque occasionnel, voire un requin blanc. Moi-même, je n’hésite aucunement à me baigner ou à passer des heures à surfer à plat ventre. Je suis pleinement conscient de la présence des requins longeant la côte, et j’y pense souvent lorsque je suis dans l’eau, mais cela ne m’arrête jamais. Il n’y a pas assez de proies naturelles pour en faire un lieu de rassemblement régulier pour les requins, alors je me lance, confiant mais néanmoins aux aguets, comme l’a peut-être fait le pagayeur hier. Cette évolution, observée en moins d’une décennie, donne un aperçu de ce qui nous attend à mesure que la population de requins blancs continue de croître dans le golfe du Saint-Laurent. »
Si la population de requins blancs continue d’augmenter, ce ne sera qu’une question de temps avant qu’un tel incident se produise dans le golfe du Saint-Laurent. Il nous semble donc essentiel d’adopter une approche proactive fondée sur l’adaptation et la diffusion de connaissances de base sur le comportement des requins afin de continuer à plonger en sécurité et dans le plaisir. Éviter les grands attroupements de phoques, surtout lorsqu’ils demeurent collés au rivage (ce qui peut indiquer la présence d’un prédateur), éviter les eaux trouble, plonger avec des armateurs locaux connaissant bien les conditions, et se tenir informé des rapports d’observation peuvent contribuer à réduire considérablement les risques. De même, les nageurs et pagayeurs doivent se montrer attentifs à la présence de phoques, et éviter les zones où ils sont concentrés.
Conclusion
Conclusion
Le golfe du Saint-Laurent et le Québec ne seront pas épargnés par la recrudescence du requin blanc dans l’Atlantique canadien. Ce retour vers ce à quoi ressemblait peut-être jadis le Saint-Laurent est déjà solidement engagé.
Comme dans d’autres régions du monde où ces interactions font partie des mœurs depuis des décennies—et même, bien plus longtemps encore, chez les peuples autochtones du golfe—il est possible de cohabiter de façon sécuritaire avec ce joueur clé de l’écosystème marin, en adoptant des comportements prudents et éclairés.
Pour en savoir plus, obtenir un contexte supplémentaire ou consulter les recommandations à l’intention des plongeurs, nageurs et autres usagers du milieu marin, veuillez consulter le Registre canadien des attaques de requins de l’ORS. Les informations relatives à l’incident du 12 août y seront également ajoutées sous peu, à la suite de l’analyse des données.
Rappel sur la protection légale et le comportement responsable
Rappel sur la protection légale et le comportement responsable
Alors que le retour en force du requin blanc incite déjà certains plongeurs et usagers du milieu marin à faire preuve de prudence à certains endroits, il pourrait également encourager des amateurs de sensations fortes à rechercher ce prédateur imposant, poussés par la curiosité, la quête d’images spectaculaires ou la visibilité médiatique. Il est donc important de rappeler que le requin blanc est une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada [3]. Ainsi, il est strictement interdit de harceler un requin blanc, notamment en s’en approchant intentionnellement à la surface—ce qui pourrait perturber un événement de prédation ou le blesser—, en le survolant avec un drone, en l’attirant avec des appâts, ou en tentant de plonger en cage sans permis de Pêches et Océans Canada (MPO).
Nous conseillons également aux plaisanciers, particulièrement ceux à bord d’embarcations légères ou pneumatiques, de maintenir une distance minimale de 10 mètres de toute activité de surface impliquant un requin blanc, en particulier lors de la consommation d’un phoque ou d’une autre carcasse, comme ce fut le cas à Gaspé le 31 juillet. Un requin blanc en situation de prédation peut adopter un comportement énergique et imprévisible, et dans de rares cas, heurter un bateau ou mordre accidentellement un boudin ou un moteur, par curiosité ou erreur. Cela pourrait entraîner des conséquences graves, telles qu’une perte d’équilibre ou une crevaison.
Aucune entrevue à ce sujet
Aucune entrevue à ce sujet
Fondé officiellement en 2003 (sous le nom de GEERG), l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) est un organisme de bienfaisance enregistré, dirigé par un petit groupe de scientifiques bénévoles et d’experts issus de domaines complémentaires, tous passionnés par les requins et profondément engagés dans leur vie professionnelle et familiale. Or, tel que mentionné précédemment, l’ORS n’est ni un organisme public ni une instance gouvernementale. En conséquence, nous ne sommes nullement tenus de publier de tels avis, et nous ne recherchons ni visibilité médiatique, ni financement dans le cadre de communications que nous jugeons d’intérêt public.
Notre engagement envers les requins du Saint-Laurent ne date pas d’hier. Actifs dans leur étude depuis les années 1990, à une époque où ces prédateurs mal-aimés nageaient dans l’indifférence, nous avons longtemps œuvré seuls, jusqu’à ce que le retour inattendu du requin blanc suscite une frénésie d’intérêt tous azimuts pour cette espèce emblématique, tant sur le plan scientifique que médiatique. Pratiquement chaque observation de requin suscite maintenant une vague de sollicitations, et nous ne disposons tout simplement pas des ressources pour répondre à une multitude de demandes d’entrevues, souvent reçues sur plusieurs jours, à toute heure.
En raison du risque de dérapage et des préjugés tenaces qui, trop souvent, déforment nos propos ou les faits rapportés—un phénomène malheureusement fréquent dans les reportages sur les requins, ici comme ailleurs—l’ORS ne donnera aucune entrevue à propos du présent avis. Nous invitons plutôt les médias à s’y référer textuellement et sans extrapolation, car il reflète notre compréhension actuelle de la présence du requin blanc dans le Saint-Laurent en lien avec la sécurité humaine. Toute spéculation au-delà de ces faits risque de donner lieu aux interprétations erronées, sensationnalistes ou banalisantes trop communes, qui ne servent ni le public ni la cause des requins.
L’ORS continuera de partager des mises à jour factuelles à mesure que ses recherches progresseront au cours des mois et des années à venir. Cependant, pour toute question relative à la présence accrue du requin blanc et, plus particulièrement, aux risques pour la sécurité publique, vous pouvez vous adresser soit au ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO), responsable de la gestion et de la surveillance de la faune marine, soit à l’organisme compétent en matière de sécurité publique sur le territoire concerné.
Merci de votre compréhension et de contribuer, avec nous, à faire en sorte que la sécurité publique et la conservation des requins restent ancrées dans les faits et le respect.
Jeffrey Gallant, M. Sc.
Fondateur et directeur scientifique
Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS)
RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCES
(1) Nous avons vu la photo de la planche endommagée, mais nous n’avons pas les droits pour la partager.
(2) Australian Shark Incident Database
(3) Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) : évaluation et rapport de situation du COSEPAC 2021
À propos
À propos
L’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS), la toute première organisation non gouvernementale et œuvre de bienfaisance sur les requins au Canada, célèbre en 2025 le 25e anniversaire de sa première expédition de terrain, qui marque également le début de son existence. Cette série d’explorations pionnières dans l’Atlantique Nord, le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent a mené à la création officielle du Groupe d’étude sur les élasmobranches et le requin du Groenland (GEERG) en 2003. Elle a également vu les premières plongées en cage avec des requins pélagiques au Canada en 2000 et, en 2003, les toutes premières rencontres naturelles avec le requin du Groenland, lançant une décennie de recherches et plusieurs publications scientifiques inédites sur cette espèce furtive et méconnue. Devenu l’Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS) en 2022, l’organisme concentre aujourd’hui ses activités bénévoles de recherche et de conservation non plus exclusivement sur le requin du Groenland, mais aussi sur l’ensemble des espèces de requins qui habitent le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, le fjord du Saguenay, le Canada atlantique et l’océan Arctique.