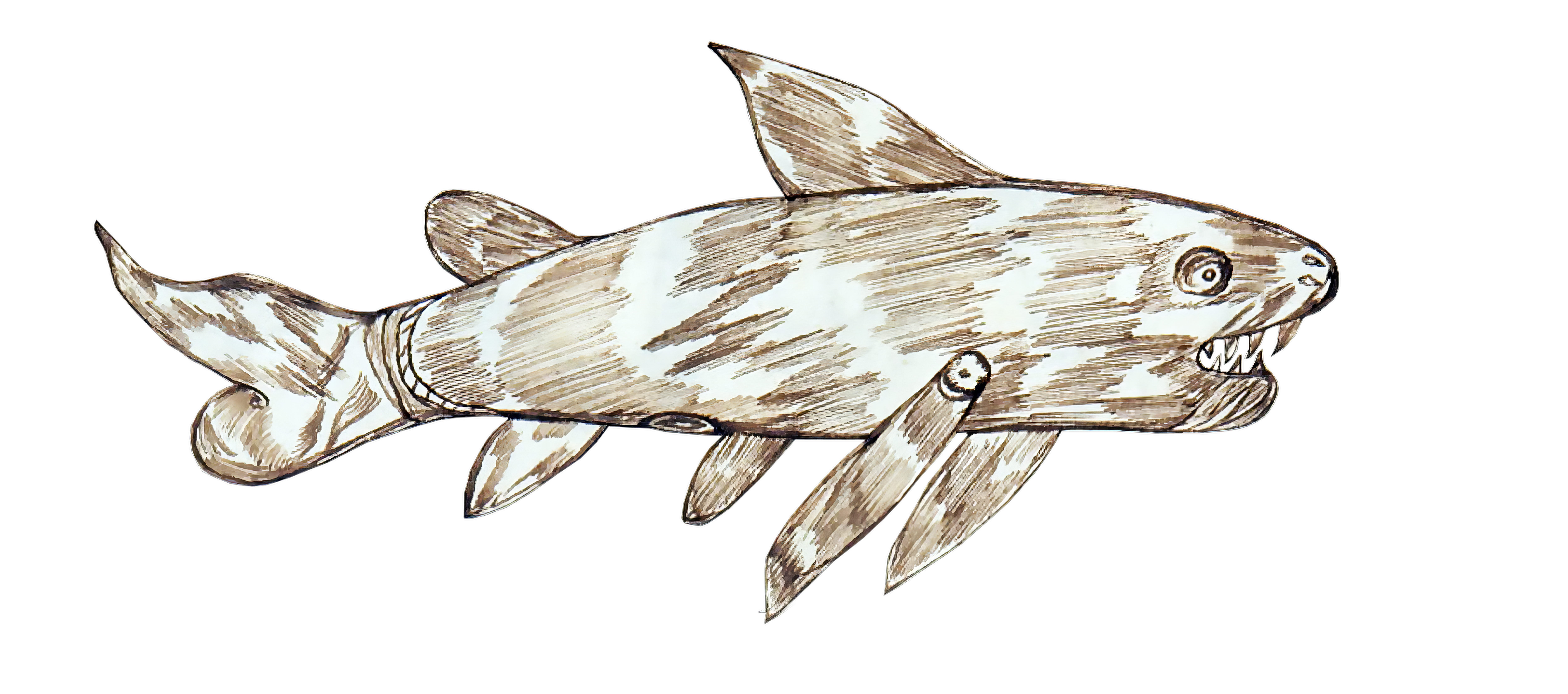Version originale publiée le 06 octobre 2010
Mise à jour le 09 janvier 2024
Version originale publiée le 06 octobre 2010
Mise à jour le 09 janvier 2024
Qui est le « tueur au tire-bouchon » ?
Qui est le « tueur au tire-bouchon » ?
En 2010, les chercheurs sur les requins Jeffrey Gallant et Chris Harvey-Clark ont participé à deux documentaires télévisés : Predator CSI: Corkscrew Killer (National Geographic Channel) et The Seal Ripper (Nature Shock). Ces productions ont mis en lumière une énigme persistante : le requin du Groenland ou le requin blanc étaient-ils réellement responsables des mystérieuses mortalités de phoques en « tire-bouchon » ? Conformément aux positions qu’ils y avaient défendues, nous n’avons jamais considéré que l’une ou l’autre de ces espèces en soit la cause.
Au début des années 1990, l’apparition régulière de carcasses de phoques mutilées à l’île de Sable, puis, plus tard, en mer du Nord, a suscité une vive controverse quant au rôle possible du requin du Groenland. Beaucoup de victimes présentaient une incision en spirale, semblable à un tire-bouchon, courant le long de leur corps. Des signalements similaires ont été rapportés en Angleterre et en Écosse à l’été 2010. À première vue, ces blessures en spirale semblaient prédatrices, mais un examen attentif montrait qu’elles ne correspondaient pas aux traces connues de morsures du requin du Groenland.
Il ne fait aucun doute que le requin du Groenland peut occasionnellement s’attaquer à des phoques vivants [1]. Cependant, les victimes sont probablement des jeunes inexpérimentés, ou des phoques endormis, distraits, blessés, coincés dans un trou de glace, ou encore surpris dans une visibilité si réduite qu’ils n’ont aucune alerte de l’approche du requin. Le requin du Groenland préfère de loin se nourrir d’un phoque déjà mort, une proie qui ne lui demande aucun effort énergétique et ne présente aucun risque de blessure. Comme Gallant l’a souligné : « Il serait illogique pour un requin du Groenland de gaspiller l’énergie vitale à sa survie sans perspective de se nourrir. » En comparaison, le requin blanc laisse des traces de morsures très différentes et reconnaissables, aujourd’hui couramment observées dans le golfe du Saint-Laurent grâce au retour de cette espèce [2].
Puisque la prédation par les requins ne correspondait pas aux preuves, une autre explication a été recherchée. L’hypothèse initiale pointait une cause mécanique : les propulseurs dynamiques carénés—propulseurs azimutaux de positionnement—utilisés par les navires de forage ou de construction hauturière dans les zones proches des échouages de carcasses à l’île de Sable et en Écosse. Ces systèmes génèrent une aspiration puissante, pouvant happer des phoques curieux et les projeter contre les pales, produisant ainsi des lacérations en spirale. Cette hypothèse a été avancée par des scientifiques écossais enquêtant sur des mortalités similaires au Royaume-Uni [3], et les premières évaluations privilégiaient les propulseurs comme cause. Des révisions ultérieures, ainsi qu’une mise à jour en 2015 de la Sea Mammal Research Unit d’Écosse, ont documenté l’ampleur de ces blessures spirales et examiné les mécanismes possibles, dont les propulseurs et la prédation biologique.

Phoques gris (Halichoerus grypus) à l’île Brion, dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. Photo © ORS | Davy Hay Gallant

Événement de cannibalisme de phoque gris (Halichoerus grypus) à l’île Brion, dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. Image de drone © ORS | Jeffrey Hay Gallant
Cependant, des travaux comportementaux et pathologiques détaillés ont depuis désigné un coupable biologique plus direct. Des phoques gris (Halichoerus grypus) ont été observés en train de tuer et de se nourrir d’autres phoques et de marsouins. En mars 2018, sur l’île de Helgoland (mer des Wadden), un phoque gris subadulte mâle a été vu capturant, tuant et consommant un jeune phoque gris. La carcasse présentait de graves lacérations cutanées, commençant à la tête et suivant un tracé hélicoïdal en spirale autour du tronc, avec décollement de la peau et manipulation étendue du lard : des lésions reproduisant le motif « au tire-bouchon » à l’origine de la controverse [4].
Des enquêtes parallèles en Écosse ont appuyé cette interprétation : l’infanticide et le cannibalisme chez le phoque gris peuvent produire des lacérations spirales indiscernables de nombreux cas historiques attribués aux propulseurs, ce qui a amené ces auteurs à conclure que la plupart des carcasses britanniques portant de telles lésions avaient été victimes de la prédation de phoques gris [5].
Nos propres observations de terrain appuient cette hypothèse. Lors de notre expédition sur le requin blanc en 2023 à l’île Brion, aux Îles-de-la-Madeleine, nous avons été témoins et avons filmé un événement de cannibalisme entre phoques gris, un phoque en tuant et en consommant un autre. Ce n’était que le deuxième cas documenté d’un tel comportement en eaux canadiennes.
Ces incidents montrent comment un phoque gris peut s’en prendre à un congénère inactif ou lent, et lui arracher la peau en bandes hélicoïdales afin d’accéder au lard riche en énergie, grâce à des attaques rapides et furtives. Ce comportement est cohérent avec les observations faites à Helgoland et ailleurs.
À l’inverse, attribuer des mutilations externes au requin du Groenland sur la seule base de leur apparence est problématique. Les preuves photographiques peuvent être brouillées par le charognage post-mortem et le transport. De plus, l’absence de tête ou de nageoires n’est pas un signe diagnostique d’alimentation par le requin du Groenland. Ce que la littérature et les observations confirment, c’est que la seule trace de morsure fiable décrite chez ce requin est un arrachement circulaire en « bouchon », et non une lacération hélicoïdale nette [6].
Dans le golfe du Saint-Laurent, qui abrite une grande population de requins du Groenland et constitue l’une des principales zones de reproduction de phoques au monde, nous n’avons jamais été témoins ni reçu de rapports de blessures en tire-bouchon. Des carcasses de phoques s’échouent parfois sur la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard, mais leurs lésions sont différentes, et beaucoup des cadavres appartiennent probablement à de jeunes phoques morts de causes naturelles au cours de leur première année. Plus récemment, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, de nombreuses carcasses portent des preuves claires d’attaques de requins blancs. Dans ce contexte, il est relativement facile de distinguer entre les blessures causées par des requins et les signes de mortalité naturelle. Le contraste réside donc entre les lésions attribuées au requin du Groenland et les lésions circulaires observées ailleurs. Pourquoi une seule espèce de requin produirait-elle des signatures alimentaires aussi radicalement différentes d’un site à l’autre ? L’interprétation la plus plausible est que les lésions en tire-bouchon ne sont pas une signature du requin du Groenland.
Le contexte environnemental plaide également contre l’implication du requin du Groenland à l’île de Sable et dans certaines parties de la mer du Nord. Les eaux autour de l’île de Sable sont peu profondes, avec une bathymétrie et des conditions saisonnières qui ne correspondent pas à l’habitat plus froid privilégié par le requin du Groenland. La profondeur moyenne et les températures de la mer du Nord limitent aussi les conditions idéales. Même si des requins du Groenland y sont présents de façon saisonnière, cela ne change rien à l’inadéquation fondamentale entre leurs traces de morsures connues et le motif « au tire-bouchon ».
Bien que des blessures mécaniques sporadiques causées par des propulseurs azimutaux puissent survenir, les observations comportementales récentes, les résultats de nécropsies et les analyses ultérieures indiquent que les lacérations en spirale, en forme de tire-bouchon, proviennent probablement de la prédation par le phoque gris, y compris du cannibalisme. Le prétendu « tueur au tire-bouchon » n’est ni le requin du Groenland ni le requin blanc. Le véritable coupable se cache à la vue de tous : un autre phoque gris.